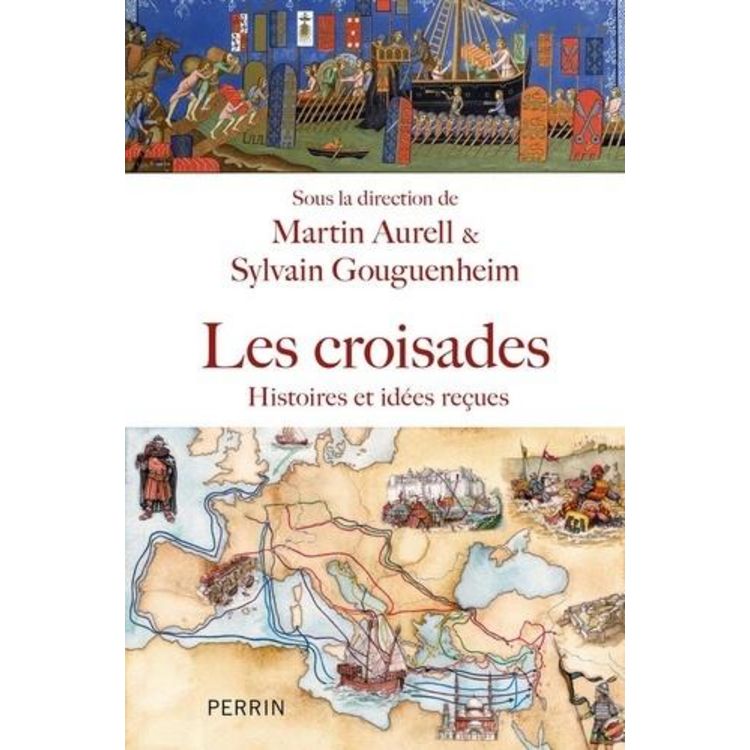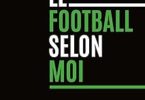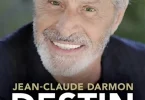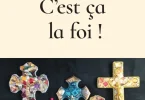La vérité sur les croisades.
Les livres sur les croisades ne se comptent plus. Nul n’ignore désormais ce qui s’est passé à Clermont en 1095, que les croisés prirent Jérusalem en 1099 ou que Saint Louis mourut devant Tunis en 1270. Mais le terme a fini par perdre en lisibilité, employé à toutes les sauces pour qualifier les conflits et tensions de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle : de George W. Bush en 2001 en passant par les djihadistes de Daesh jusqu’aux diverses » croisades » contre le cancer ou la Covid-19… Afin de conjurer l’histoire du passé, il est temps de rappeler ce que les historiens ont patiemment débusqué en analysant de près les documents d’époque, littéraires ou archéologiques.
Plus que de mettre à mal quelques idées reçues – non, les croisés n’étaient pas des anthropophages qui cherchaient à envahir le monde islamique… -, la formidable équipe d’historiens réunis par Martin Aurell et Sylvain Gouguenheim montre la complexité du phénomène en mettant en avant nombre d’aspects méconnus : sait-on ainsi que les croisades continuèrent bien après la mort de Saint Louis et l’officielle » huitième croisade » ? Que des croisés partirent en nombre en direction de la Baltique ? Qu’une guerre dite » sainte » n’est pas nécessairement une croisade et qu’une croisade n’est pas un » djihad chrétien » ? Que le monde arabo-musulman y fut largement indifférent en dehors des territoires directement concernés par les combats ? Que des chrétiens s’y opposèrent, tandis que d’autres firent souche sur place, donnant naissance à des sociétés originales, en Syrie ou en Morée ? Sait-on enfin que ce monde de guerriers fit leur place en nombre à des femmes, pour des rôles variés ?
Un ouvrage inédit, savant, mais vivant et souvent surprenant, rompant en visière avec bien des mythes.
C’est un ouvrage collectif réunissant une vingtaine de contributions d’historiens spécialistes du Moyen Âge. Il vise à déconstruire les idées reçues autour des croisades — c’est-à-dire les mythes, les simplifications, les usages anachroniques du mot « croisade », les représentations contemporaines, etc.
Parmi les thèmes traités (liste non exhaustive) :
-
définition de ce que fut une croisade, ses variations selon le temps et le lieu.
-
les motivations religieuses, politiques, sociales des participants et des commanditaires.
-
les croisades hors de la Terre sainte (Espagne, Baltique, Albigeois, etc.)
-
la perspective musulmane ou orientale, les conséquences sur les sociétés locales, etc.
-
le rôle des femmes, les croisades populaires, la notion de guerre sainte vs djihad, etc.
L’ouvrage paraît à un moment opportun : les croisades sont souvent mobilisées dans les discours contemporains (politiques, culturels, etc.), parfois de manière simpliste ou polémique.
Points forts
Complexité et nuance
Le livre rend justice à la complexité du phénomène des croisades, brise de nombreuses idées reçues, montre que ce n’est pas un phénomène monolithique. On comprend que ce qui est en jeu va bien au-delà de la simple conquête religieuse : politique, économie, culture, société, foi, etc.
Perspective large
Il ne se limite pas à la Terre sainte, mais aborde les croisades en Europe, les ordres militaires, les dimensions sociales et culturelles, l’expérience des femmes, les perspectives musulmanes, etc. Cela donne une vision plus équilibrée et plus riche.
Mise au clair des notions
Le livre insiste sur le problème des anachronismes (employer le mot ‘croisade’ dans les temps anciens, confondre guerre sainte et croisade, etc.), ce qui est très utile pour le lecteur non spécialiste.
-
Erudition
Les contributions sont de haut niveau, bien documentées, avec une bibliographie, etc. Pour un amateur éclairé ou pour l’enseignement, c’est une ressource précieuse. -
Accessibilité relative
Bien que savant, de nombreux comptes rendus indiquent que le style est vivant, que le livre est souvent surprenant, ce qui permet de garder le lecteur intéressé malgré la matière dense.
Pour certains lecteurs, la multitude des contributions, la richesse des détails, peuvent être un peu écrasantes. On peut sentir qu’il y a parfois un excès de précision qui nuit à la fluidité pour le lecteur profane. -
Fragmentation
Parce que ce sont des chapitres écrits par différents spécialistes, les approches varient, le ton varie, les niveaux de détail varient. Cela peut donner l’impression d’une mosaïque dont les tesselles ne s’emboîtent pas toujours parfaitement pour construire un récit linéaire. Audience limitée ?
Bien que le livre soit plus accessible que certains textes purement universitaires, il reste dense et suppose une base un peu solide en histoire médiévale pour profiter pleinement des nuances. Pour quelqu’un qui ne connaît presque rien aux croisades, certains chapitres pourraient être ardus. -
Place des sources orientales
Même si le livre aborde la perspective musulmane ou orientale, certains critiques soulignent que ce n’est pas toujours avec le même niveau d’archive ou de profondeur que pour les sources chrétiennes ou latines. Ce déséquilibre est un défi commun dans l’historiographie des croisades. (Il n’est pas certain qu’il soit grave dans ce cas, mais c’est parfois mentionné comme un point à surveiller dans tout ouvrage de ce type.) -
Risque d’abstraction
Lorsque l’on déconstruit beaucoup d’idées reçues, on court aussi le risque de trop intellectualiser, de donner une vision très académique, parfois éloignée de l’imaginaire collectif, ou de ne pas entrer assez dans l’expérience vécue des individus croisés ou des populations affectées. Certains lecteurs peuvent regretter moins de récits vivants, moins de témoignages personnels.
-
Beaucoup d’idées reçues courantes (et parfois modernes) sont clairement remises en question : le comparatif “croisade vs djihad chrétien”, la croyance que les croisades ont continué comme expéditions massives après certaines dates, l’homogénéité des croisades, etc.
-
Le livre aide à comprendre comment le concept de croisade a évolué, pas seulement comme phénomène historique, mais comme élément de mémoire, d’imaginaire, de rhétorique politique jusqu’à aujourd’hui.
-
Il permet aussi de voir l’impact des croisades sur des territoires moins souvent traités, comme la Baltique ou la Morée franque, des croisades populaires, etc., ce qui enrichit le panorama.
Pour qui ce livre est-il recommandé
-
Pour les étudiants, enseignants d’histoire, amateurs sérieux du Moyen Âge.
-
Pour ceux qui veulent aller au-delà des idées convenues, des clichés, et comprendre les croisades dans toute leur complexité.
-
Pour ceux qui s’intéressent aux rapports entre histoire et mémoire, aux usages politiques ou culturels de l’histoire.
Si vous êtes plutôt un lecteur occasionnel ou un chercheur de très centré sur les batailles ou les grands personnages, il pourrait être un peu lourd ou exigeant.
En conclusion
Je trouve que Les croisades – Histoires et idées reçues est un ouvrage très réussi, utile, et nécessaire. Il contribue à corriger les distorsions dans la compréhension populaire (et souvent médiatique) des croisades, tout en fournissant une base solide d’historiographie récente. Même avec ses limites de densité ou de richesse qui peuvent décourager certains, je le considère comme une référence moderne pour quiconque veut comprendre ce phénomène historique dans toute sa complexité.
T.Youf
Les Croisades. Histoires et idées reçues », sous la direction de Martin Aurell et Sylvain Gouguenheim, Perrin, 400 p., 23,50 €, numérique 16 €.